
Il est incontestable que l'article 544 du code civil régissant le droit de propriété n'a pas été modifié depuis 1804 (il a une valeur supralégislative) et que la monoculture sucrière n'a fait que s'accentuer depuis 1860 ; et si les progrès techniques peuvent augmenter la productivité, ils ne peuvent raccourcir notablement ni les cycles végétatifs ni le temps de croissance des animaux !
Au moment où la France républicaine, incitée par des grands créoles (de Mahy, Brunet, Drouhet, Dureau de Vaulcomte, etc) arguant de "droits anciens", établit son protectorat sur la Grande-Île, à la Réunion toutes les terres cultivables sont concédées, occupées, - et même au-delà, puisque le conflit entre les propriétaires et le domaine est loin d'être réglé. La situation est catastrophique. Pendant que le paludisme décime les populations, le "borer" s'attaque à la canne.
La production de sucre, après avoir chuté d'un tiers, stagne. Café, épices, cultures vivrières, à l'exception du maïs et du manioc, ont presque disparu. Le géranium commence sa conquête des forêts primaires de l'Ouest et du Sud, alors que vétiver et ylang-ylang ne sont pas produits en quantité suffisante pour être exportés. Seule la vanille, qui passe de 15 tonnes en 1860 à 200 tonnes en 1898, entretient la confiance. Depuis des décennies, et notamment grâce à Julien Gaultier de Rontaunay, qui a réussi à s'associer à Ranavalo 1ère et dont la flotte a compte jusqu'à 1 000 marins, le ravitaillement de l'île en riz, grains et viande de boeuf est tributaire de Madagascar. Et le mirage de cet espace immense, peu peuplé, réputé plein de richesses, suscite des espoirs démesurés...
Au début du siècle dernier, dans la région, Gallieni et son action monopolisent l'attention. Paradoxalement, c'est le violent cyclone de 1904 qui, par ses destructions, nous fait toucher le fond de l'abîme et... rebondir grâce à une subvention et un prêt sans intérêt de dix millions chacun. Les combats des années 1915-1916 annihilent la production betteravière du Nord de la France et, en 1917, le gouvernement décide la réquisition des sucres coloniaux disponibles à un cours supérieur à celui du marché. En effet, jusqu'à cette date, le planteur restait propriétaire du sucre : en échange des cannes livrées à l'usine, il recevait un bon de 65,5 kg de sucre par tonne de canne. Ce forfait représentait en principe les deux tiers du sucre extrait, le dernier tiers restant acquis à l'usinier. Le rhum étant un sous-produit restait propriété de l'usinier qui le distillait. En pratique, le sucre était entreposé dans les docks (les magasins du CPR) et les bons s'échangeaient par l'intermédiaire des courtiers de commerce à un cours variable. Cette augmentation du prix du sucre permit aux usiniers de trouver les capitaux nécessaires à la modernisation des plus rentables, notamment le Gol.
Parallèlement, le comte Choppy aliène ses propriétés du Sud et son usine de Grands-Bois, pendant que le domaine Kervéguen est vendu par lots. Et l'on vit l'apparition de nouveaux propriétaires qui n'avaient pas souffert des expropriations du Crédit foncier et n'hésitaient pas à emprunter, ainsi que la constitution des premières sociétés anonymes.
Contingentement et blocus
À partir de 1923, le gouvernement décide la limitation à 150 000 hl d'alcool pur l'importation des rhums coloniaux (tafias) en France et les rhums hors contingent sont soumis à une taxe prohibitive. En 1924, la Réunion se voit attribuer un contingent de 24 000 hl, qui profite aux seuls distillateurs. Mais les plantations de betterave reconstituées, la surproduction fait son apparition. Et en 1927, une entente (guère cordiale) accorde aux sucriers métropolitains 87 % des besoins de la consommation métropolitaine et algérienne et aux colonies 13 %. En 1930, un arbitrage de Léonus Bénard portera la part du planteur à 70 kg de sucre par tonne de canne dans la partie du vent et à 75 kg dans la partie sous-le-vent. Le cours du sucre étant en baisse, la commission consultative de l'agriculture fait admettre en 1933 l'attribution aux planteurs du tiers du contingent global de rhum, qui est alors fixé à 30 000 hl. La répartition entre les intéressés se fait au prorata des cannes livrées.
Ce marasme explique la mise en sommeil de la Société hydroélectrique de la Réunion, qui devait, en turbinant à Takamaka les eaux de la rivière des Marsouins, permettre l'électrification de l'île en général et du chemin de fer en particulier. C'est aussi en 1933 qu'est créée la station expérimentale de recherche génétique de la Bretagne et les premières caisses régionales et locale du Crédit agricole... Après la "drôle de guerre" au printemps 1940, les généraux de Hitler, au lieu de s'attaquer à la ligne Maginot, où on les attend de pied ferme, traversent la Belgique et foncent sur Paris, pendant qu'à Dunkerque les Anglais regagnent leur île. L'Assemblée nationale confie les pleins pouvoirs au maréchal Pétain rappelé d'Espagne et le général de Gaulle lance de Londres son appel à la résistance. Le 23 juin, le gouverneur de Maurice demande officiellement à Pierre Aubert, son homologue qui vient de prendre ses fonctions, que la Réunion continue "à se battre la main dans la main avec lui".
Choisissant la légalité républicaine et le ralliement au régime de Vichy, Aubert déclenche le blocus économique de l'île, condamnée à une autarcie alimentaire La production de sucre en progression constante depuis 1920 est passée de 42 000 à 110 000 tonnes. Le premier souci des autorités est de stocker ce qui ne peut plus être exporté. Puis elles prescrivent d'arracher les cannes et de les remplacer par du maïs, du riz et surtout du manioc. Malgré cela, en janvier 1943, le nouveau gouverneur Capagorry doit demander l'envoi de toute urgence de 12 000 tonnes de riz, 8 000 tonnes de maïs et 4 200 tonnes de légumes secs, pour éviter la famine. En 1944, la production de sucre n'est plus que de 13 000 tonnes. La ruine !
Au moment où la France républicaine, incitée par des grands créoles (de Mahy, Brunet, Drouhet, Dureau de Vaulcomte, etc) arguant de "droits anciens", établit son protectorat sur la Grande-Île, à la Réunion toutes les terres cultivables sont concédées, occupées, - et même au-delà, puisque le conflit entre les propriétaires et le domaine est loin d'être réglé. La situation est catastrophique. Pendant que le paludisme décime les populations, le "borer" s'attaque à la canne.
La production de sucre, après avoir chuté d'un tiers, stagne. Café, épices, cultures vivrières, à l'exception du maïs et du manioc, ont presque disparu. Le géranium commence sa conquête des forêts primaires de l'Ouest et du Sud, alors que vétiver et ylang-ylang ne sont pas produits en quantité suffisante pour être exportés. Seule la vanille, qui passe de 15 tonnes en 1860 à 200 tonnes en 1898, entretient la confiance. Depuis des décennies, et notamment grâce à Julien Gaultier de Rontaunay, qui a réussi à s'associer à Ranavalo 1ère et dont la flotte a compte jusqu'à 1 000 marins, le ravitaillement de l'île en riz, grains et viande de boeuf est tributaire de Madagascar. Et le mirage de cet espace immense, peu peuplé, réputé plein de richesses, suscite des espoirs démesurés...
Au début du siècle dernier, dans la région, Gallieni et son action monopolisent l'attention. Paradoxalement, c'est le violent cyclone de 1904 qui, par ses destructions, nous fait toucher le fond de l'abîme et... rebondir grâce à une subvention et un prêt sans intérêt de dix millions chacun. Les combats des années 1915-1916 annihilent la production betteravière du Nord de la France et, en 1917, le gouvernement décide la réquisition des sucres coloniaux disponibles à un cours supérieur à celui du marché. En effet, jusqu'à cette date, le planteur restait propriétaire du sucre : en échange des cannes livrées à l'usine, il recevait un bon de 65,5 kg de sucre par tonne de canne. Ce forfait représentait en principe les deux tiers du sucre extrait, le dernier tiers restant acquis à l'usinier. Le rhum étant un sous-produit restait propriété de l'usinier qui le distillait. En pratique, le sucre était entreposé dans les docks (les magasins du CPR) et les bons s'échangeaient par l'intermédiaire des courtiers de commerce à un cours variable. Cette augmentation du prix du sucre permit aux usiniers de trouver les capitaux nécessaires à la modernisation des plus rentables, notamment le Gol.
Parallèlement, le comte Choppy aliène ses propriétés du Sud et son usine de Grands-Bois, pendant que le domaine Kervéguen est vendu par lots. Et l'on vit l'apparition de nouveaux propriétaires qui n'avaient pas souffert des expropriations du Crédit foncier et n'hésitaient pas à emprunter, ainsi que la constitution des premières sociétés anonymes.
Contingentement et blocus
À partir de 1923, le gouvernement décide la limitation à 150 000 hl d'alcool pur l'importation des rhums coloniaux (tafias) en France et les rhums hors contingent sont soumis à une taxe prohibitive. En 1924, la Réunion se voit attribuer un contingent de 24 000 hl, qui profite aux seuls distillateurs. Mais les plantations de betterave reconstituées, la surproduction fait son apparition. Et en 1927, une entente (guère cordiale) accorde aux sucriers métropolitains 87 % des besoins de la consommation métropolitaine et algérienne et aux colonies 13 %. En 1930, un arbitrage de Léonus Bénard portera la part du planteur à 70 kg de sucre par tonne de canne dans la partie du vent et à 75 kg dans la partie sous-le-vent. Le cours du sucre étant en baisse, la commission consultative de l'agriculture fait admettre en 1933 l'attribution aux planteurs du tiers du contingent global de rhum, qui est alors fixé à 30 000 hl. La répartition entre les intéressés se fait au prorata des cannes livrées.
Ce marasme explique la mise en sommeil de la Société hydroélectrique de la Réunion, qui devait, en turbinant à Takamaka les eaux de la rivière des Marsouins, permettre l'électrification de l'île en général et du chemin de fer en particulier. C'est aussi en 1933 qu'est créée la station expérimentale de recherche génétique de la Bretagne et les premières caisses régionales et locale du Crédit agricole... Après la "drôle de guerre" au printemps 1940, les généraux de Hitler, au lieu de s'attaquer à la ligne Maginot, où on les attend de pied ferme, traversent la Belgique et foncent sur Paris, pendant qu'à Dunkerque les Anglais regagnent leur île. L'Assemblée nationale confie les pleins pouvoirs au maréchal Pétain rappelé d'Espagne et le général de Gaulle lance de Londres son appel à la résistance. Le 23 juin, le gouverneur de Maurice demande officiellement à Pierre Aubert, son homologue qui vient de prendre ses fonctions, que la Réunion continue "à se battre la main dans la main avec lui".
Choisissant la légalité républicaine et le ralliement au régime de Vichy, Aubert déclenche le blocus économique de l'île, condamnée à une autarcie alimentaire La production de sucre en progression constante depuis 1920 est passée de 42 000 à 110 000 tonnes. Le premier souci des autorités est de stocker ce qui ne peut plus être exporté. Puis elles prescrivent d'arracher les cannes et de les remplacer par du maïs, du riz et surtout du manioc. Malgré cela, en janvier 1943, le nouveau gouverneur Capagorry doit demander l'envoi de toute urgence de 12 000 tonnes de riz, 8 000 tonnes de maïs et 4 200 tonnes de légumes secs, pour éviter la famine. En 1944, la production de sucre n'est plus que de 13 000 tonnes. La ruine !


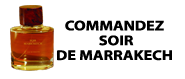
 Le Parfumeur
Le Parfumeur Le Parfumeur
Le Parfumeur




