
Le Piton de la Fournaise sur l'Ile de la Réunion. Photo Richard Bouhet (AFP/Archives)
Le parc des Hauts de l'île de la Réunion, qui concerne essentiellement les zones montagneuses, est implanté sur l'un des 25 "points chauds" les plus riches en biodiversité de la planète. Il comprend un volcan très actif, le Piton de la Fournaise, dont la dernière éruption, le 18 février, a duré 9 heures.
Comme celui de Guyane, officialisé fin février, il a bénéficié de la nouvelle loi sur les parcs nationaux qui distingue un "coeur" intégralement protégé et une zone d'adhésion volontaire des communes du parc.
Au total, il couvre les deux tiers du territoire insulaire - 1.650 km2 sur les 2.500 que compte l'île -, dont une zone centrale de 100.000 ha, étagée de 0 à 3.000 m d'altitude et présentant des milieux océaniques et tropicaux.
La zone "coeur" du parc protège 42% de l'île avec de nombreuses espèces endémiques (propres à ce territoire).
"Pour la première fois, la France, qui n'avait plus créé de parcs nationaux depuis 18 ans, crée un parc national dans un contexte géographique contraint et à fort dynamisme démographique", a relevé le ministère de l'Ecologie.
On estime qu'il y a eu 60 fois plus d'exctinctions d'espèces dans les collectivités d'Outremer qu'en métropole au cours des quatre derniers siècles, rappellent les experts du ministère.
"A la Réunion, la principale menace vient des espèces végétales envahissantes qui ont détruit énormément d'espèces locales", explique Bernard Cressens, directeur scientifique et spécialiste de l'Outremer au WWF-France.
Les périls sont essentiellement liés à des facteurs d'origine humaine comme le développement de l'urbanisation, l'intensification de l'agriculture, la construction d'infrastructures, notamment touristiques et les pollutions qu'elles entraînent.
Faisant valoir la très forte demande des élus locaux, Bernard Cressens estime que ce nouveau parc pourrait devenir un "modèle d'exemplarité d'ici une dizaine d'années".
Les dérogations accordées à des activités industrielles déjà existantes dans le périmètre du parc, comme une usine de géothermie, ont suscité un débat animé avec les organisations de protection de la nature.
"Il est clair que nous aurions préféré que cette usine soit exclue de la zone coeur", indique Gilles Benest, représentant de la fédération France Nature Environnement (FNE) au Conseil national de protection de la nature. "Mais sur le papier, le parc propose une protection du patrimoine naturel de bonne qualité".
De son côté, le ministère avait fait valoir lors de la présentation du projet que le parc de la Réunion couvre, pour sa zone coeur, 40% du territoire contre 0,7% pour l'ensemble des parcs de métropole.
Le Parc national de la Réunion s'ajoute aux deux réserves naturelles nationales existantes et à la récente réserve naturelle nationale marine, créée par décret du 21 février dernier, qui assure la protection des milieux coralliens et des ressources halieutiques sur 3.500 hectares.
Comme celui de Guyane, officialisé fin février, il a bénéficié de la nouvelle loi sur les parcs nationaux qui distingue un "coeur" intégralement protégé et une zone d'adhésion volontaire des communes du parc.
Au total, il couvre les deux tiers du territoire insulaire - 1.650 km2 sur les 2.500 que compte l'île -, dont une zone centrale de 100.000 ha, étagée de 0 à 3.000 m d'altitude et présentant des milieux océaniques et tropicaux.
La zone "coeur" du parc protège 42% de l'île avec de nombreuses espèces endémiques (propres à ce territoire).
"Pour la première fois, la France, qui n'avait plus créé de parcs nationaux depuis 18 ans, crée un parc national dans un contexte géographique contraint et à fort dynamisme démographique", a relevé le ministère de l'Ecologie.
On estime qu'il y a eu 60 fois plus d'exctinctions d'espèces dans les collectivités d'Outremer qu'en métropole au cours des quatre derniers siècles, rappellent les experts du ministère.
"A la Réunion, la principale menace vient des espèces végétales envahissantes qui ont détruit énormément d'espèces locales", explique Bernard Cressens, directeur scientifique et spécialiste de l'Outremer au WWF-France.
Les périls sont essentiellement liés à des facteurs d'origine humaine comme le développement de l'urbanisation, l'intensification de l'agriculture, la construction d'infrastructures, notamment touristiques et les pollutions qu'elles entraînent.
Faisant valoir la très forte demande des élus locaux, Bernard Cressens estime que ce nouveau parc pourrait devenir un "modèle d'exemplarité d'ici une dizaine d'années".
Les dérogations accordées à des activités industrielles déjà existantes dans le périmètre du parc, comme une usine de géothermie, ont suscité un débat animé avec les organisations de protection de la nature.
"Il est clair que nous aurions préféré que cette usine soit exclue de la zone coeur", indique Gilles Benest, représentant de la fédération France Nature Environnement (FNE) au Conseil national de protection de la nature. "Mais sur le papier, le parc propose une protection du patrimoine naturel de bonne qualité".
De son côté, le ministère avait fait valoir lors de la présentation du projet que le parc de la Réunion couvre, pour sa zone coeur, 40% du territoire contre 0,7% pour l'ensemble des parcs de métropole.
Le Parc national de la Réunion s'ajoute aux deux réserves naturelles nationales existantes et à la récente réserve naturelle nationale marine, créée par décret du 21 février dernier, qui assure la protection des milieux coralliens et des ressources halieutiques sur 3.500 hectares.


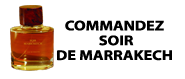
 Le Parfumeur
Le Parfumeur Le Parfumeur
Le Parfumeur




