
Le nil et le désert egyptien, vus par un satellite de la Nasa
Le Centre commun de recherches (JRC) de la Communauté européenne à Ispra (nord de l'Italie) développe un système d'alerte précoce sur ce fléau, qui concerne les deux tiers du continent.
"Certains endroits sont surveillés tous les jours depuis 25 ans. Ici, on utilise une dizaine de satellites qui nous permettent de dresser un inventaire détaillé de la couverture terrestre, de l'état de la végétation, des ressources en eau et de l'affectation des sols: leur conversion à l'agriculture ou la déforestation peuvent être suivies avec une grande précision", explique Andreas Brink, chercheur allemand de l'Unité de surveillance globale de l'environnement.
De plus en plus, les clichés des satellites, notamment américains, sont mis rapidement et gratuitement à la disposition des chercheurs: leur analyse, croisée avec les données du terrain - températures, climat, population, activités agricoles et industrielles - définissent les tendances.
"La désertification est un processus complexe et de long terme, qui implique le climat, la démographie et de nombreux facteurs physiques et sociaux. Depuis une dizaine d'années, le Sahel semble reverdi sur les clichés, mais la végétation a changé, sa valeur (des graminées, du bush) n'est plus la même et on n'y cultive plus", indique-t-il.
Désignant sur ses écrans des tâches jaunes-orangées dans le nord-est de la Namibie, il explique qu'à cet endroit, la dégradation des sols est surtout due au surpâturage, qui crée une pression intense sur les sols et les empêche de se régénérer, faute de rotations. Or dans les 30 prochaines années, sous l'effet du changement climatique, la région devrait recevoir de moindres précipitations, prévient-il.
Outre les facteurs environnementaux - érosion éolienne et hydraulique notamment - la pression démographique est l'une des principales causes de désertification en provoquant poussées urbaines et développement agricole.
En comparant deux cartes du Soudan établies en 1975 et 2000, Andreas Brink pointe de nouvelles zones d'irrigation intensives sur 10 km de long. En Afrique de l'ouest, l'observation des relevés de 1984 et de 2002 a fait apparaître une poussée agricole aux frontières du parc naturel "W", aux confins du Bénin, du Niger et du Burkina Faso.
"Les cultures et l'élevage ont un fort impact sur la désertification", note le chercheur en désignant une large bande jaune qui, du Golfe de Guinée en passant par la moitié sud du Nigeria, s'étend jusqu'au Cameroun et au Gabon: la population y a augmenté de 60% en 30 ans. Parallèlement, de 1975 à 2000, chaque année les surfaces agricoles ont crû de 1,78%, la forêt a diminué de 0,2 % et la végétation naturelle de 1% par an: "Il est important de vérifier si la dégradation aujourd'hui ralentit ou s'accélère".
La désertification signifie moins de terre pour l'agriculture, donc plus de bêtes en pâture au m2 et des risques de conflits d'usages entre pasteurs et fermiers, résume Andreas Brink. La sécheresse dans le nord du Kenya suscite régulièrement des affrontements, mortels, entre communautés rivales.
"La désertification, comme le changement climatique, sont des processus lents, rappelle-t-il. Ce n'est pas comme un tsunami, mais ça tue lentement énormément de monde".
"Certains endroits sont surveillés tous les jours depuis 25 ans. Ici, on utilise une dizaine de satellites qui nous permettent de dresser un inventaire détaillé de la couverture terrestre, de l'état de la végétation, des ressources en eau et de l'affectation des sols: leur conversion à l'agriculture ou la déforestation peuvent être suivies avec une grande précision", explique Andreas Brink, chercheur allemand de l'Unité de surveillance globale de l'environnement.
De plus en plus, les clichés des satellites, notamment américains, sont mis rapidement et gratuitement à la disposition des chercheurs: leur analyse, croisée avec les données du terrain - températures, climat, population, activités agricoles et industrielles - définissent les tendances.
"La désertification est un processus complexe et de long terme, qui implique le climat, la démographie et de nombreux facteurs physiques et sociaux. Depuis une dizaine d'années, le Sahel semble reverdi sur les clichés, mais la végétation a changé, sa valeur (des graminées, du bush) n'est plus la même et on n'y cultive plus", indique-t-il.
Désignant sur ses écrans des tâches jaunes-orangées dans le nord-est de la Namibie, il explique qu'à cet endroit, la dégradation des sols est surtout due au surpâturage, qui crée une pression intense sur les sols et les empêche de se régénérer, faute de rotations. Or dans les 30 prochaines années, sous l'effet du changement climatique, la région devrait recevoir de moindres précipitations, prévient-il.
Outre les facteurs environnementaux - érosion éolienne et hydraulique notamment - la pression démographique est l'une des principales causes de désertification en provoquant poussées urbaines et développement agricole.
En comparant deux cartes du Soudan établies en 1975 et 2000, Andreas Brink pointe de nouvelles zones d'irrigation intensives sur 10 km de long. En Afrique de l'ouest, l'observation des relevés de 1984 et de 2002 a fait apparaître une poussée agricole aux frontières du parc naturel "W", aux confins du Bénin, du Niger et du Burkina Faso.
"Les cultures et l'élevage ont un fort impact sur la désertification", note le chercheur en désignant une large bande jaune qui, du Golfe de Guinée en passant par la moitié sud du Nigeria, s'étend jusqu'au Cameroun et au Gabon: la population y a augmenté de 60% en 30 ans. Parallèlement, de 1975 à 2000, chaque année les surfaces agricoles ont crû de 1,78%, la forêt a diminué de 0,2 % et la végétation naturelle de 1% par an: "Il est important de vérifier si la dégradation aujourd'hui ralentit ou s'accélère".
La désertification signifie moins de terre pour l'agriculture, donc plus de bêtes en pâture au m2 et des risques de conflits d'usages entre pasteurs et fermiers, résume Andreas Brink. La sécheresse dans le nord du Kenya suscite régulièrement des affrontements, mortels, entre communautés rivales.
"La désertification, comme le changement climatique, sont des processus lents, rappelle-t-il. Ce n'est pas comme un tsunami, mais ça tue lentement énormément de monde".


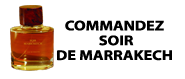
 Le Parfumeur
Le Parfumeur Le Parfumeur
Le Parfumeur




