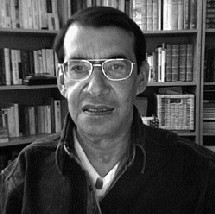
Ethnobotanistes marocains : Jamal Bellakhdar
Il a reçu trois fois le prix Maroc du livre en 1979, 1997 et 2003. En tant que citoyen attaché à la défense des droits de l'homme et de la démocratie, il soutient l'action d'Amnesty international.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur les populations maghrébines et leurs traditions :
- Médecine traditionnelle et toxicologie ouest sahariennes (éditions Techniques nord-africaines),
- Tissint, une oasis du Maroc présaharien (en collaboration avec A. Benahid, j. Vittoz et I. Maréchal, éditions Al Biruniya),
- Pharmacopée marocaine traditionnelle (édition Ibis Press).
Le jardin pour Jamal Bellakhdar est un lieu de tensions entre deux imaginaires, l'un représentant le mondain (al-dounia) et l'autre l'audelà (al-akhira), entre le local et le global ensuite, enfin entre l'utilitaire et l'agrément.
Il explique dans un entretien avec Jean François Clément pour notre magazine Jardins du Maroc jardin du monde, les tentions du jardin marocain :
A l'intérieur du monde arabo-musulman, le Maroc a donné naissance à une société spécifique d'horticulteurs. Dans cette aire culturelle, le jardin est une fusion de deux images, une modélisation idéalisée des deux mondes, le monde d'en bas, avec, d'une part, son modèle de l'oasis, lieu de la vie, de la fécondité en milieu aride, de l'ombre, du repos et de l'autosuffisance et, d'autre part, le paradis, un lieu de résidence éternelle imaginé et construit conformément aux attentes des humains, un lieu où toutes leurs frustrations seront levées.
L'ordre du jardin, bien qu'il soit conçu selon des standards d'esthétique humaine, est à l'image de celui de l'univers, et rend compte d'une certaine façon de la totale interdépendance de l'homme et de son monde.
Il ajoute pour la tension du local et du global que tous les jardiniers du monde constituent d'abord leurs jardins à partir des plantes fournies par l'environnement immédiat. Aujourd'hui, les jardins du Maroc connaissent un joyeux mélange de plantes, ce qui est la conséquence d'une mondialisation botanique qui a précédé l'actuelle phase de mondialisation puisque, dans le domaine de l'échange des plantes et des connaissances, celle-ci a commencé avec les premières migrations humaines et les premières relations commerciales.
On pourrait citer en vrac les arbres les plus communément utilisés pour agrémenter les riyâd-s comme le citronnier, le cédratier, l'arbre de Judée, le cyprès, le palmier-dattier, le grenadier, le figuier, le cognassier, la vigne, le poirier, le bananier, le jujubier cultivé, le mûrier.
Il faudrait ajouter également les plantes qui poussent en contrebas des allées, dans les parterres, comme les rosiers, les jasmins, les œillets, les giroflées, les narcisses, les hyacinthes, les roses trémières, le basilic, la marjolaine. De nos jours, on y trouve aussi des espèces ornementales qui n'ont rien de typique et qui modifient la physionomie du jardin marocain traditionnel.
Pour la troisième tension de l'utilitaire et l'agrément il dit : le jardin peut servir à produire des plantes pour sa propre alimentation ou pour celle des autres. C'est ce que l'on appelle un jardin de rapport (arsat). Les jardins urbains marocains sont situés au cœur même de la maison (riyâd-s) ou dans son prolongement immédiat. Ces jardins, de la même manière que la maison arabe, sont des espaces fermés n'ouvrant sur l'extérieur qu'en direction du ciel.
La part de l'agrément est capitale dans les demeures princières, qu'il s'agisse des jardins de Madinat Al-Zahra, en Andalousie, des palais marocains, de Dar Batha à Fès ou de la Bahia à Marrakech, construit par les deux grands vizirs Si Moussa et Ba-Ahmed, du palais du Dey à Alger ou des résidences beylicales de Tunis.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur les populations maghrébines et leurs traditions :
- Médecine traditionnelle et toxicologie ouest sahariennes (éditions Techniques nord-africaines),
- Tissint, une oasis du Maroc présaharien (en collaboration avec A. Benahid, j. Vittoz et I. Maréchal, éditions Al Biruniya),
- Pharmacopée marocaine traditionnelle (édition Ibis Press).
Le jardin pour Jamal Bellakhdar est un lieu de tensions entre deux imaginaires, l'un représentant le mondain (al-dounia) et l'autre l'audelà (al-akhira), entre le local et le global ensuite, enfin entre l'utilitaire et l'agrément.
Il explique dans un entretien avec Jean François Clément pour notre magazine Jardins du Maroc jardin du monde, les tentions du jardin marocain :
A l'intérieur du monde arabo-musulman, le Maroc a donné naissance à une société spécifique d'horticulteurs. Dans cette aire culturelle, le jardin est une fusion de deux images, une modélisation idéalisée des deux mondes, le monde d'en bas, avec, d'une part, son modèle de l'oasis, lieu de la vie, de la fécondité en milieu aride, de l'ombre, du repos et de l'autosuffisance et, d'autre part, le paradis, un lieu de résidence éternelle imaginé et construit conformément aux attentes des humains, un lieu où toutes leurs frustrations seront levées.
L'ordre du jardin, bien qu'il soit conçu selon des standards d'esthétique humaine, est à l'image de celui de l'univers, et rend compte d'une certaine façon de la totale interdépendance de l'homme et de son monde.
Il ajoute pour la tension du local et du global que tous les jardiniers du monde constituent d'abord leurs jardins à partir des plantes fournies par l'environnement immédiat. Aujourd'hui, les jardins du Maroc connaissent un joyeux mélange de plantes, ce qui est la conséquence d'une mondialisation botanique qui a précédé l'actuelle phase de mondialisation puisque, dans le domaine de l'échange des plantes et des connaissances, celle-ci a commencé avec les premières migrations humaines et les premières relations commerciales.
On pourrait citer en vrac les arbres les plus communément utilisés pour agrémenter les riyâd-s comme le citronnier, le cédratier, l'arbre de Judée, le cyprès, le palmier-dattier, le grenadier, le figuier, le cognassier, la vigne, le poirier, le bananier, le jujubier cultivé, le mûrier.
Il faudrait ajouter également les plantes qui poussent en contrebas des allées, dans les parterres, comme les rosiers, les jasmins, les œillets, les giroflées, les narcisses, les hyacinthes, les roses trémières, le basilic, la marjolaine. De nos jours, on y trouve aussi des espèces ornementales qui n'ont rien de typique et qui modifient la physionomie du jardin marocain traditionnel.
Pour la troisième tension de l'utilitaire et l'agrément il dit : le jardin peut servir à produire des plantes pour sa propre alimentation ou pour celle des autres. C'est ce que l'on appelle un jardin de rapport (arsat). Les jardins urbains marocains sont situés au cœur même de la maison (riyâd-s) ou dans son prolongement immédiat. Ces jardins, de la même manière que la maison arabe, sont des espaces fermés n'ouvrant sur l'extérieur qu'en direction du ciel.
La part de l'agrément est capitale dans les demeures princières, qu'il s'agisse des jardins de Madinat Al-Zahra, en Andalousie, des palais marocains, de Dar Batha à Fès ou de la Bahia à Marrakech, construit par les deux grands vizirs Si Moussa et Ba-Ahmed, du palais du Dey à Alger ou des résidences beylicales de Tunis.


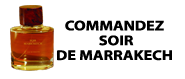
 Le Parfumeur
Le Parfumeur Le Parfumeur
Le Parfumeur




