
Texte Véronique Bruez
De quand date votre découverte du Maroc ?
Après Tanger où nous étions arrivés en fuyant l’occupation nazie, puis des études aux USA, je suis venue retrouver mes parents au Maroc en 1943, après le débarquement américain. Ma mère avait déjà fait un voyage avec ses parents en 1920 dans toute l’Afrique du Nord, mon père aussi, de son côté, avant leur rencontre, était venu ici du temps de Lyautey.
Mon passé au Maroc est important dans ma vie, j’y ai vécu des moments magnifiques, dans un Maroc très différent de celui d’aujourd’hui. Avec mes parents je me suis jointe à la démarche des Français Libéraux et nous avons lutté pour que ce pays retrouve son indépendance. J’ai connu la génération des Marocains qui ont milité pour cette cause. Après l’indépendance, le climat était celui de l’espérance, nous croyions que beaucoup de choses seraient possibles. Je me souviens que dans le méchouar de Rabat par exemple, il y avait des tribus qui campaient et les gens dansaient l’ahouach. En ville on voyait partout du théâtre spontané dans la rue...
Vous étiez et vous restez une femme militante, quels ont été vos engagements ?
J’ai vécu dans la perspective de tout ce qui pouvait se faire pour transformer ce pays. Balafrej, le premier ministre des affaires étrangères du Maroc m’a appelée pour participer à la naissance du service culturel. C’était l’époque où une vaste campagne d’alphabétisation était lancée. Avec des amis nous avons participé à la construction d’une école à Salé.
Medhi Ben Barka, que j’avais connu par sa sœur, m’avait aussi demandé de participer au journal de l’Istiqlal en tenant une rubrique sur la femme marocaine. J’ai formé une petite équipe qui s’appelait Amina. J’ai aussi participé à Manar el Maghrib qui était un journal pour néo-alphabètes. J’ai passé mon brevet d’arabe classique.
Avec Yves Goussault qui avait travaillé auprès de l’Abbé Pierre aux chantiers d’Emmaüs en France, nous avons ensuite accompagné une tournée de conférences de Josué de Castro au Maroc. Nous nous sommes aperçus de l’enthousiasme et de l’attente des populations. Nous nous sommes dit : « Comment faire pour que les fellahs connaissent le plan de développement en élaboration ? Comment impliquer les gens ? » A cette époque-là, Ben Barka était président du Conseil consultatif et avait lancé l’idée de la route de l’unité qui unissait le Maroc auparavant sous protectorat français et espagnol. C’était l’organisation d’un vaste chantier civique réunissant des jeunes de tout le pays.
Pourquoi vous être tournée vers le monde rural ?
D’abord parce que j’ai passé mon enfance à la campagne et qu’à l’époque où je vivais au Maroc, l’idée importante était qu’il fallait développer le monde rural si l’on voulait empêcher l’exode vers les villes et la paupérisation, visible dans le phénomène des bidonvilles. Je connaissais Omar Ben Chemsi, le premier gouverneur de Marrakech. Je lui ai parlé de notre idée d’organiser une rencontre entre les gens du monde rural et les responsables du développement. Il a tout de suite soutenu cette idée avec Thami Amar, responsable de l’agriculture pour la Province. Yves Goussault et moi avons donc fait partie de l’équipe qui a préparé cette rencontre avec Ben Chemsi et tous les responsables de la Province dès l’automne 56. Elle eut lieu en août 57, cela fait 50 ans cette année ! Nous avions prévu des sorties sur le terrain pour sensibiliser les gens et leur faire connaître, par exemple, les chantiers de petits barrages et d’épierrages pour regagner des terrains, des plantations. La question de la santé était aussi abordée avec l’implantation d’infirmeries rurales. Notre souci s’étendait aussi à l’entretien des pistes, à l’entretien et à la préservation de la forêt. Tout le monde s’est mobilisé : agriculteurs, moqqadems et autres responsables locaux. Après cette rencontre, Ben Chemsi nous a demandé de continuer à organiser d’autres stages dans la région.
Comment cette idée s’est-elle développée ?
Un beau jour, M’hamdi, le ministre de l’intérieur a voulu étendre cette expérience à tout le Maroc. Il nous a fallu alors constituer une équipe et ce fut la naissance de l’association IRAM (Institut de Recherche et d’Application des Méthodes de Développement). Le père Lebret, un Dominicain qui est à l’origine des enquêtes participatives, avait à la même époque été invité au Sénégal pour conseiller le plan de développement. Il était au courant de notre travail au Maroc et il dit aux Sénégalais qu’il ne pouvait y avoir de plan sans animation. Le Sénégal a donc envoyé des stagiaires pour s’initier au travail d’animation au Maroc. C’était une expérience neuve pour la coopération, nous apportions notre temps et notre expérience et la Province organisait et assumait le coût des rencontres. A cette même époque, à Tioumliline s’organisaient des rencontres internationales. Il y avait dans le pays une dynamique d’ouverture, un climat propice au changement et une volonté collective. L’expérience de Marrakech a donc essaimé sur une bonne partie du territoire marocain. De fait, cette action d’éducation populaire était une véritable action d’éducation civique car elle touchait à tous les domaines d’intervention et d’organisation du fonctionnement de l’Etat. Je me souviens par exemple des exercices communaux que nous organisions lors des stages dans les années 58 pour préparer la réforme communale et l’organisation des premières élections communales.
Cette expérience a-t-elle essaimé ?
J’ai donc été co-fondatrice de l’IRAM International et nous avons aussi créé une association IRAM Maroc. Dans cette expérience d’animation rurale, nous étions alors des pionniers et nous fûmes invités à aider à monter des actions d’animation dans d’autres pays d’Afrique puis d’Amérique latine. Mais après 62, vu les tensions politiques, le travail est devenu difficile. Pendant un temps après la création de l’Office National des Irrigations (ONI) nous y avons travaillé sur demande du directeur. Après mon départ du Maroc en 1964, j’ai continué de travailler avec l’équipe de l’IRAM jusque dans la fin des années 60. Puis, en 1970 j’ai accepté une mission du Conseil Oecuménique des Eglises en Amérique latine pour définir les critères de sélection des projets. Ce fut le début de mon engagement en Amérique latine après un premier voyage en 61 à Cuba. J’ai alors ré-appris l’espagnol et appris le portugais, mais, avec la pratique intensive de ces deux langues, j’ai malheureusement en grande partie oublié l’arabe.
Quel est votre lien avec le Maroc aujourd’hui ?
Ce qui m’amène régulièrement à revenir ici, c’est mon intérêt pour la population marocaine que j’ai appris à aimer au long de toutes ces années. Je veux mieux comprendre quelles sont actuellement les initiatives intéressantes qui se développent dans cette société qui a tellement changé. La mémoire, ma mémoire, et mon passé ici me motivent pour réapprendre ce pays. Aujourd’hui, que puis-je faire pour aider à consolider toutes les démarches porteuses d’avenir ? Un jour, en 2003, j’ai reçu un dépliant sur la Caravane du Livre, une opération organisée par Jamila Hassoune. J’étais alors de passage à Rabat et je suis venue à Marrakech la rencontrer et découvrir son travail, ses actions pour la promotion en faveur du livre et de la lecture, de la culture plus généralement en milieu rural et pour les jeunes. C’est une initiative importante pour la démocratisation du savoir et Jamila s’y consacre avec passion et pratiquement sans moyens autres que la richesse des relations humaines. J’admire son acharnement et souhaite contribuer à appuyer ce travail.
Comment voyez-vous actuellement Marrakech ?
Tout d’abord je voudrais dire mon émotion, lors de notre tournée dans les collèges et lycées de la région, de rencontrer cette jeunesse si ouverte et accueillante, avide d’apprendre et tant de professeurs passionnés par leur travail. C’est une grande richesse pour l’avenir de ce pays.
Je suis passionnée par le rapport à la vie en général, je m’intéresse à l’aventure humaine et aux différentes cultures et j’ai toujours admiré dans la civilisation marocaine l’amour des jardins. La Ménara, pour moi, à l’époque où j’ai vécu ici, était le lieu où je me retrouvais moi-même dans la nature et dans l’histoire. La Ménara est le symbole tangible de l’harmonie entre l’oeuvre de l’homme et de la nature. J’ai un rapport très fort avec la nature et je pense que nous avons voulu la conquérir mais que nous avons oublié de la respecter. Depuis l’origine, il y a l’intervention de l’humain, la transformation. J’aime au contraire, reprenant un titre de René Dubos, l’idée de courtiser la terre. Courtisons la terre, c’est ce qui me semble le plus intéressant car cela suppose aussi un autre rapport entre les êtres humains. Je suis désolée de voir ce qu’est devenue la Ménara et je m’inquiète beaucoup de toute la spéculation de luxe qui, comme partout, approfondit les inégalités, renchérit la vie pour la population de revenu modeste et les plus pauvres, et menace aussi l’approvisionnement en eau.
Pouvez-vous me parler des dernières formes qu’a prises votre action ? Quels nouveaux engagements votre vision du monde contemporain a-t-elle suscités ?
En France, je fais partie de différentes associations et nous formons un réseau de personnes qui ont des appartenances diverses, font des choses différentes mais qui se retrouvent sur des idées fondamentales quant à nos responsabilités humaines. Nous sommes proches de Patrick Viveret, qui est philosophe et magistrat à la Cour des Comptes, auteur d’un passionnant rapport intitulé « Reconsidérer la richesse », publié en 2002 aux éditions de l’Aube. Il est à l’origine de la création d’un collectif « nouvelles richesses » auquel je participe et qui veut porter un autre regard sur la réalité du monde actuel. Il a lancé l’idée des Dialogues en Humanité mettant l’accent sur notre responsabilité en tant qu’espèce dans la plupart des malheurs qui nous frappent. Gérard Collomb, maire du Grand Lyon, a repris cette idée pour la Ville et je participe à un comité qui s’est constitué pour organiser des activités qui tendent à sensibiliser les habitants de Lyon et d’ailleurs à cette perspective. Celle d’agir sur nos comportements individuels et collectifs pour mieux vivre ensemble et changer notre regard sur la politique. Je me suis aussi, depuis son lancement en 2001, engagée dans le processus du Forum Social Mondial. Je crois beaucoup aux réseaux d’échanges d’expériences ; j’ai également été co-fondatrice, en 1975, du CEDAL,
Centre d’Etudes et de Développement en Amérique Latine qui a beaucoup travaillé dans cette perspective. Actuellement, grâce à la rencontre des Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs, je suis aussi associée à une démarche pour créer un Mouvement International de Réciprocité et Réseaux de Savoirs. Or la démarche de la Caravane du Livre rentre tout à fait dans cette perspective.
Je veux contribuer à lutter contre les inégalités, changer les rapports du vivre ensemble car il y a trop de dédain de la part de beaucoup envers les plus défavorisés. La question de la dignité et du respect est au cœur de ma réflexion, tout comme celle de la nécessité de la reconnaissance de la valeur de tout être humain. A mon échelle, j’essaye de militer pour la capacité de chaque personne à se réaliser et je souligne notre responsabilité à nous, Européens, par rapport à des drames comme celui des migrations. Nous vivons une époque de transformations profondes et de grands dangers menacent notre espèce et la planète, dus à la folie humaine et à l’argent roi. Je vois pourtant beaucoup d’initiatives qui donnent espoir mais qui sont dispersées et malheureusement peu valorisées. Il y a tant à faire !


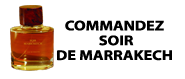
 Le Parfumeur
Le Parfumeur Le Parfumeur
Le Parfumeur




