
l'Atlas marocain
Les différentes formes d'aires protégées dans le Haut Atlas (Parc, Réserves biologiques, SIBEs) sont confrontées à la faible adhésion de la population locale, qui n'y reconnaît qu'une simple limitation d'accès aux ressources naturelles et aux espaces pastoraux de la part de l'administration des Eaux et Forêts.
L'analyse scientifique de la pratique de l'Agdal, sur le plan de la biologie de la conservation, apporte des renseignements importants sur les bases et fondements de la gestion de la ressource convoitée.
Trois points sont à retenir, (1) la reconnaissance d'une valeur donnée à la biodiversité (pastorale, biomasse, énergie, bois d'œuvre,…), (2) la durabilité et la pérennité de cette ressource, (3) la concertation et la gestion des conflits autour l'accès à cette biodiversité.
Dans la pratique de l'Agdal, ces trois idées sont mises en œuvre par un processus impliquant :
- une identification (1) précise de l'élément de la ressource (biodiversité) à conserver (espèces, éléments d'espèces, espace, éléments d'espace).
- une implantation territoriale (2) reconnue et respecter par tous les acteurs de la pratique de l'Agdal.
- une spatialisation de la pratique par un mode de réglementation communautaire (3) et concerté de l'accès à la ressource par les hommes et le bétail.
- une gestion du facteur temps (4) garantissant l'accumulation de la biomasse, le bouclage du cycle biologique des plantes, et le recrutement d'un nouveau stock de graines dans le sol.
En perspective, deux questions s'imposent :
- De quelle façon, les Agdals, en tant qu'aires protégées communautaires, peuvent trouver une place dans la stratégie nationale des aires protégées ?
- De quelle façon, les renseignements tirés de la pratique de l'Agdal peuvent constituer des éléments fondateurs pour une meilleure gestion de la Biodiversité dans les aires protégées marocaines ?
L'analyse scientifique de la pratique de l'Agdal, sur le plan de la biologie de la conservation, apporte des renseignements importants sur les bases et fondements de la gestion de la ressource convoitée.
Trois points sont à retenir, (1) la reconnaissance d'une valeur donnée à la biodiversité (pastorale, biomasse, énergie, bois d'œuvre,…), (2) la durabilité et la pérennité de cette ressource, (3) la concertation et la gestion des conflits autour l'accès à cette biodiversité.
Dans la pratique de l'Agdal, ces trois idées sont mises en œuvre par un processus impliquant :
- une identification (1) précise de l'élément de la ressource (biodiversité) à conserver (espèces, éléments d'espèces, espace, éléments d'espace).
- une implantation territoriale (2) reconnue et respecter par tous les acteurs de la pratique de l'Agdal.
- une spatialisation de la pratique par un mode de réglementation communautaire (3) et concerté de l'accès à la ressource par les hommes et le bétail.
- une gestion du facteur temps (4) garantissant l'accumulation de la biomasse, le bouclage du cycle biologique des plantes, et le recrutement d'un nouveau stock de graines dans le sol.
En perspective, deux questions s'imposent :
- De quelle façon, les Agdals, en tant qu'aires protégées communautaires, peuvent trouver une place dans la stratégie nationale des aires protégées ?
- De quelle façon, les renseignements tirés de la pratique de l'Agdal peuvent constituer des éléments fondateurs pour une meilleure gestion de la Biodiversité dans les aires protégées marocaines ?


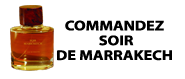
 Le Parfumeur
Le Parfumeur Le Parfumeur
Le Parfumeur




